“Écrire, c’est une façon de parler sans être interrompu” (Jules Renard)
 l’homme armée
l’homme armée
Frédéric Coché – Frémok
Après le héros triomphante, l’homme armée. Le mélange des genres est annoncé dans le titre. Pas au sens de l’identité sexuelle, mais de la liberté narrative. La seule règle est d’alterner par doubles pages les gravures (eaux fortes) et les peintures (à huile). Liberté dans le récit qui démarre comme un conte moyenâgeux montrant une espèce de golem renverser une armée à lui tout seul. Il est secondé, peut-être même conduit par un power ranger à pistolets soudain alter-ego de l’auteur. Le monstre prend le fils, peut-être, le père un peu plus tard, avant de retrouver la matrice. Peu importe. Seuls compte le choc visuel et l’effet induit. Il y a là comme une respiration, un rebond incessant. Le trait puis la tâche, la couleur et son absence, trivialité organique contre sobriété monochrome. La violence, par exemple, ne s’exprime pas avec la même intensité selon la matière utilisée, l’huile ou l’acide. L’exploration se joue de l’académisme. “C’est dans la reformulation que se situe le discours artistique”, dit Frédéric Coché, qui réinterprète quelques standards de la Renaissance (Paolo Uccello ? Jan Van Eyck ?). La façon de raconter est ici bien plus intéressante que ce qui est raconté. Contrairement à un livre n’ayant pour lui que son histoire, et qui perdra tout intérêt une fois l’histoire résolue, celui-ci conserve l’attention. On reprendra immédiatement sa lecture. Et on y reviendra encore, demain ou plus tard. La fascination reste intacte.
L’histoire de la Ve République
Thomas Legrand et François Warzala – Les Arènes BD
Un remarquable condensé de conformisme. Le tâcheron s’applique à tracer le contour des cases et des phylactères, tire la langue pour dessiner des bonshommes aussi ressemblants que possible. Pas de prise de risque, aucune imagination. Le dessin doit rester au service, support d’un cours magistral dispensé par l’éditorialiste politique de France inter. Sur le contenu, dédié aux “règles de notre jeu démocratique”, pas de prise de risque non plus, pas de questionnement intempestif. Legrand convoque les notions de peuple et de démocratie comme si elles allaient de soi. Bien qu’il soit un pur produit de la cinquième (pour ne pas l’être, il faut avoir plus de 60 ans), il appréhende l’Histoire à la façon d’un manuel scolaire de la quatrième. Georges Perec disait, à propos de ces manuels, qu’ils illustraient “efficacement l’enseignement d’une histoire feinte où les événements, les idées et les (grands) hommes se mettent en place comme les pièces d’un puzzle“. Entre Malet, Isaac et Gala, la république de Thomas Legrand ne s’intéresse qu’à ceux qui la président. Les zévénements. Les grandes dates. Des conversations d’alcôve. Legrand adore ça, jusqu’à se mettre en scène en train de dialoguer avec les grands hommes. On trouvera un chapitre consacré à leur vie privée, un autre détaillant chaque photo officielle. Et ces cases qui montrent jeune Chirac à l’écoute de son transistor tandis que Bernadette Chodron de Courcel fait la vaisselle, ou petit Sarko devant sa TV, dans les starting-blocks de leurs destins respectifs, placent définitivement ce livre au registre d’une propagande néo-religieuse, loin de toute rigueur émancipatrice. De l’expression populaire, il ne sera presque jamais question sinon sous forme d’ “opinion” convoquée à deux ou trois reprises, ou de l’inévitable Mai 68 estudiantin. Comme si la population n’était que spectatrice d’une représentation. Concept intéressant, qui ne sera hélas pas survolé par le professeur Legrand. Dans une envolée solennelle, il écrit : “Les présidents sont seuls… Leur immense pouvoir est aussi une très lourde responsabilité. Ils sont au cœur du tragique de l’Histoire”. C’est beau comme du Stan Lee. Hommage anthume : l’inventeur de Spiderman et l’éditorialiste de France inter partageaient de façon évidente la même passion pour les super-héros.
Atom agency, les bijoux de la Bégum
Yann et Schwartz – Dupuis
Un détective fait ses premières armes, épaulé par un mastard et une jeune femme de tempérament. La jeune femme de tempérament, c’est cette fille qui, dans la bd à papa, sert de faire-valoir au mâle blanc du premier plan quand les autres agrémentent les fonds de case au même titre que les autobus et les réverbères. Schwartz dessine très bien. Il dessine comme dessinait Chaland dans le style “atome” de Marcinelle, celui de Tillieux et de Jijé leur maître à tous. Atome, Atom agency : la vie est bien faite. Il y a une quarantaine d’années, Yves Chaland s’imposa dans Métal hurlant avec des récits respectant scrupuleusement les codes graphiques d’une certaine bande dessinée d’après guerre, mais qui, empreints d’une impertinence inenvisageable avant les années punk, sanctionnaient la fin de l’innocence. Cette modernité paradoxale reste caractéristique des années quatre-vingt. De la même génération que Chaland, Yann et Conrad bousculaient alors les colonnes de Spirou avec leurs Innommables, et aussi des hauts de page qu’ils animèrent en ricanant au grand dam des gardiens du temple. Sales gosses. Chaland est mort en 90. Conrad a repris le dessin d’Astérix en 2013. Yann n’est plus un sale gosse depuis longtemps, passé du côté des gardiens du temple. Quel est son propos ? Faut-il, une fois que tout a été fait, déconstruire la déconstruction des années quatre-vingt ? Est-ce un travail de faussaire, de la brocante de pacotille ? Yann et Schwartz rendent-ils seulement hommage à Tillieux – on notera que la structure de l’agence Atom décalque celle de Gil Jourdan ? Font-ils du Chaland qui ferait du Jijé ? Le moins qu’on puisse dire, c’est que le dispositif est essoré. La lecture des bijoux de la Bégum est longue comme un déjeuner dominical chez ce très vieil oncle qui nous initia jadis à la bande dessinée. Ça sent le renfermé. Ça ressasse une nostalgie qui n’est plus celle des vivants. C’est un peu triste.
Jheronimus & Bosch
Paul Kirchner – Tanibis
Ne retrouve pas la fulgurance surréaliste d’un Bus indépassable. Le programme était pourtant alléchant. Un certain Jheronimus, voyou ordinaire, meurt en volant un canard en plastique (le Bosch de l’intitulé). Condamné à l’enfer, il subira les gentils sévices d’une horde de diablotins roses et taquins. Très peu de folie. Des fourches pour piquer les fesses, quelques flammes bien prévisibles et beaucoup trop de matières fécales pour étouffer le supplicié. Invoquer le grand peintre du fantasmagorique ne garantit hélas pas l’inspiration.
 Servir le peuple
Servir le peuple
Yan Lianke & Alex W. Inker – Sarbacane
Usant avec jubilation des codes graphiques de la propagande maoïste, ce récit n’a pas tant pour objet de moquer la normalisation idéologique que décrire une passion moite. Malgré les conventions qui leur imposent de rester à distance, deux corps se rapprochent. On peut même dire que les conventions boostent le rapprochement puisque le sens du devoir attise la frustration, que la culpabilité et la crainte de la punition exacerbent le désir. Les amants coupables continueront d’ailleurs d’utiliser le langage de la propagande après avoir piétiné les icônes de la révolution. Étonnant Alex W. Inker, qui change radicalement d’ambiance en adaptant le roman d’un ancien militaire chinois après sa biographie du boxeur panaméen Al Brown . “Grande sœur, tu es la plus grande contre-révolutionnaire du monde ! Tu es la plus grande espionne infiltrée au sein du parti ! Et tu m’aimes dix mille fois plus que je t’aime !” Réactionnaire ? D’accord. À condition que la réaction soit sexuelle.
 L’ogre amoureux
L’ogre amoureux
Nicolas Dumontheuil – Futuropolis
Un ogre est terriblement amoureux d’une femme qu’il ne connaît pas encore. Ayant décidé de se marier demain, il convoque l’aide d’un (rusé) renard pour trouver la belle. Fable méchante puisant chez Perrault, Peyo, Hergé, Morris… Et aussi un peu chez Ed Gein, le psychopathe qui inspira Psychose et Massacre à la tronçonneuse. Tout ça en couleurs printanières et scènes bucoliques charmantes. L’œuvre de Dumontheuil dessine la folie des êtres humains, plus ou moins douce selon les volumes. On est ici sur la crête de la vague dépressive avec des animaux nettement plus raisonnables que les figures d’humains qui les bouffent. Voilà une saine et réjouissante lecture.
 Sabrina
Sabrina
Nick Drnaso – Presque lune
Si Mark Zuckerberg faisait de la bande dessinée, ça pourrait ressembler à ça. Un dessin asocial. Droites perpendiculaires, droites parallèles. De belles cases bien tracées et peu de personnages alentour. Une jeune femme a disparu, abandonnant ses proches à la dépression. Son amoureux Teddy n’arrive plus à mettre un pied devant l’autre et se fait héberger par un vieux copain qui traverse lui-même une passe délicate sur le plan affectif. L’effacement de Sabrina deviendra l’objet d’une “théorie alternative”. Parce que l’exercice du pouvoir s’accommode de la corruption et des faux-semblants, parce que les médias appuient trop souvent la roublardise de leurs puissants propriétaires, certains déboussolés – comment ne pas l’être ? – trouvent leur épiphanie dans le scepticisme systématique : la vérité est ailleurs, sur le comptoir de ce café du commerce planétaire qu’on nomme réseaux sociaux. Le véritable objet du livre n’apparaît que tardivement, Nick Drnaso prend le temps d’installer tous les éléments. C’est un livre sur la rumeur. C’est un livre sur la dépossession : de l’être aimé, de la peine afférente, du deuil, de la vérité, jusqu’à ce que nous soyons dépossédés de notre propre existence. À qui se trouve emporté dans le maëlstrom de la rumeur ne reste que l’attente d’un autre fait divers qui chassera le précédent en traînant derrière lui la cohorte des trolls, conspirationnistes et autres experts de la vérité vraie. S’il ne fallait retenir qu’un passage de ce second ouvrage publié en France (après Beverly, primé au dernier festival d’Angoulême), la mise à plat en seulement deux pages de l’emballement collectif, quand lors d’une réunion d’un groupe de parole la sœur de la disparue liste de façon chronologique quelques messages reçus après la révélation du drame. Vertigineux et glaçant : à lire absolument.
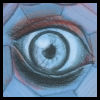 Le rire de l’ogre
Le rire de l’ogre
Sandrine Martin, d’après Pierre Péju – Casterman
Les livres de Sandrine Martin, aussi différents soient-ils, se révèlent aussi doux au regard que rugueux à l’âme. Ce sont souvent des histoires (ou des instantanés, comme dans La montagne de sucre) d’amours chagrines. Étendu sur deux décennies, Le rire de l’ogre accompagne l’apprentissage amoureux et artistique d’un jeune homme né juste après la seconde guerre mondiale. Impossibles résiliences, collapsus et leurs conséquences, des regrets, des remords, aussi le portrait difficilement saisissable d’une femme libre et indocile. Sandrine Martin a trouvé dans le livre éponyme de Pierre Péju, avec qui elle avait déjà collaboré en 2014 (Pourquoi moi je suis moi chez Gallimard jeunesse), un matériau de premier choix pour alimenter son œuvre sensible. Remarquable.
 Negalyod
Negalyod
Vincent Perriot – Casterman
Science-fiction post-apocalypto-écologique. Le désert s’est étendu, peuplé de dinosaures pouvant servir de monture ou de nourriture aux humains qui les élèvent. Des camions sillonnent cette terre asséchée pour provoquer des orages qui alimenteront en eau la mégapole où se concentre l’essentiel de la population. Au plus près des ptérodactyles, la classe dominante. La tour la plus haute abrite le complexe qui administre la cité dans la plus parfaite opacité. Un couple de jeunes gens est appelé à conduire la rébellion contre un système inique… Trame classique. Si Vincent Perriot convoque les sombres perspectives du capitalisme totalitaire, qui nourrit son jusqu’au-boutisme d’une technophilie sans discernement (contrôle des vivants par le réseau informatique, bio-ingéniérie etc.), son ambition première reste le divertissement. L’anticipation a toujours permis de conjuguer alerte et récréation. L’écueil était peut-être ici de travailler un univers visuel bien rebattu. Moebius, qui ne renierait ni le propos ni la filiation graphique, a imposé des codes difficilement dépassables. Mais Perriot trouve la singularité en se faisant démiurge d’un monde plus inspiré de l’art primitif des populations autochtones d’Océanie et d’Amérique que d’une projection futuriste de la modernité occidentale.
 Isles
Isles
Jérémy Perrodeau – 2024 / FP&CF
Une espèce d’échauffement pour le formidable Crépuscule (chez 2024 en 2017, et il est très curieux d’écrire ce genre de choses), où apparaissait déjà cette envie de chatouiller les paysages naturels avec des formes géométriques. Un trio de guerriers débarque sur une île, ils se séparent pour monter des machins, courir de droite à gauche et tuer des gens. Action pure à une longue vue de distance, n’attendez aucun atermoiement métaphysique ou existentiel. De loin (de la longue vue, donc), on pourra spéculer sur une connexion avec le Prison pit de Johnny Ryan, par la succession de gestes qui n’ont de but que leur existence même, la violence gore et le nihilisme en moins.
Les rigoles
Brecht Evens – Actes sud
Une nuit de fête à Paris. Quatrième livre publié en France (encore un pavé, on a coupé beaucoup d’arbres pour cette rentrée littéraire) et Brecht Evens patine. Dresse le portrait choral de jeunes gens dépressifs et égocentrés, errant de boîte en boîte parce qu’il faut bien s’occuper. Ennui bavard, dandysme, sexe et drogues sur 330 pages. Un air de déjà lu (Les noceurs). Toujours aussi ravissant d’aquarelles, mais bien creux.
Soirée d’un faune
Ruppert et Mulot – L’Association
Ruppert et Mulot s’amusent en changeant les supports mais déclinent toujours le même motif : corps agités – ici on danse, trivialités sexuelles, découpage au sabre de samouraï… L’objet : une grande image sous-titrée “ballet dessiné” qui se déplie façon carte routière. Concept. Et ? Et rien. À tel point que les auteurs ont estimé nécessaire d’expliquer leur démarche au dessus des crédits d’usage. La chose est suffisamment exceptionnelle pour être remarquée, l’Association ayant toujours rechigné à renseigner les quatrièmes de couverture au motif que les livres n’ont sans doute pas besoin de notice explicative pour être lus. Alors Ruppert et Mulot invoquent Debussy et Mallarmé. Question : s’ils s’étaient attelés à une “soirée aux rigoles”, pour faire écho à l’essoufflement maniéré de Brecht Evens, l’image aurait-elle produit moins de corps agités, moins de trivialités sexuelles, moins de jeunes gens modernes avec des sabres de samouraï ? Obsédés par le changement de forme, Ruppert et Mulot seraient surtout bien inspirés de changer de système.
 Desh
Desh
Tofépi – L’Association
Desh, pas Daesh. Ni la dèche, quoique : Tofépi est de ces auteurs qui savent ce que minima sociaux veut dire. Notons, même si ça n’a rien à voir, qu’il s’est fait une spécialité des sandalettes, quelque peu précurseur dans la mode de la claquette-chaussette. “Desh”, celui de Bangladesh, signifie “pays” en bengali. Au milieu des années 2000, Tofépi accompagne au pays sa tante, son mari et leurs deux enfants pour un mariage dans la famille, histoire de s’éloigner de papa-maman et rompre avec la monotonie. Ce n’est pas une résolution personnelle, on l’a poussé dans l’avion. On dirait que Tofépi est plus enclin à l’observation distanciée qu’à l’initiative enthousiaste. Sa piètre motivation ne lui permettra pas d’incarner le standard du touriste béat, féru d’exotisme et d’altérité. Et le périple aboutira une décennie plus tard à ce livre qui ne donne pas envie de faire du tourisme. Ajoutons que le dessin n’est pas très aimable, souvent sacrifié au texte, puis arrêtons de charger la barque. Car on n’est pas entré ici comme dans le dépliant promotionnel d’un office de tourisme. Et au final, sens du rythme et résignation permanente articulent un humour qui emporte la mise.
 Malaterre
Malaterre
Pierre-Henry Gomont – Dargaud
Quelque part en Afrique équatoriale. Un type mal embouché entreprend de redorer le blason familial en rachetant une demeure construite par ses aïeux et l’exploitation forestière qui va avec. Malaterre expose le rapport toxique de ce type à ses enfants enlevés à leur mère. Ils apprendront à surmonter – un temps – l’inconséquence paternelle et à aimer ce pays luxuriant qui s’ouvre à leur désir adolescent de liberté. Le texte est finement ciselé et le dessin, particulièrement expressif, illustre à merveille l’emprise de la nature comme l’outrance du personnage principal. Après Pereira prétend, un autre livre d’excellente facture par un des auteurs les plus captivants de l’époque.
Post scriptum : à voir (après lecture ?), un entretien promotionnel auquel s’est soumis Pierre-Henry Gomont. Pas que ce genre d’objet présente habituellement un intérêt majeur, mais il permettra peut-être d’envisager dans le cas présent la distance entre l’intention et la réception de l’œuvre. Gomont dit avoir nourri le récit de son histoire personnelle et parle du personnage central comme d’un “connard sympathique”. “Il fait tout pour qu’on ne l’aime pas et on l’aime quand même”… Est-il bien question de ce pervers narcissique raciste et violent, à qui l’auteur ne fait grâce d’aucune ambiguïté rédemptrice tout au long des 190 pages ? Si Gabriel Lesaffre peut certainement fasciner les lecteurs, suscitera-t-il leur sympathie ? C’est comme si l’aveuglement de Gomont pour sa créature rejoignait celui de l’enfant pour son père défaillant : l’amour inconditionnel transcende l’évidence, les observateurs extérieurs seront à la fois plus lucides et peut-être moins à même de ressentir les choses. Finalement, quelle importance ? L’œuvre échappe à son créateur tout comme l’enfant s’émancipe, c’est là une magie de la littérature.

