“Il y a trois sortes de critiques : ceux qui ont de l’importance ; ceux qui en ont moins ; ceux qui n’en ont pas du tout. Les deux dernières sortes n’existent pas : tous les critiques ont de l’importance” (Erik Satie)
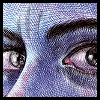 Moi, ce que j’aime, c’est les monstres – livre premier
Moi, ce que j’aime, c’est les monstres – livre premier
Emil Ferris – Monsieur Toussaint Louverture
L’inévitable de la rentrée. Ne boudons pas notre enthousiasme, au regard de la sidération que provoque une lecture forte d’un souffle graphique et narratif peu communs. Un souffle qui ne nous avait pas décoiffés depuis, disons, l’Asterios Polyp de Mazzucchelli. Que partagent formellement ces deux livres, indépendamment du volume et de la pagination, anecdotique comparaison ? Une intégration active de l’écriture dans le récit. L’éditeur des Monstres dit que le lettrage à la main (d’Amandine Boucher, respect) permet que “les mots soient chargés d’émotion”. Ce lettrage est surtout indissociable du dessin au stylo-bille d’Emil Ferris. L’occasion de vérifier que les lettres peuvent aller bien au delà du simple commentaire de l’image, quand les collègues systématisent les polices numériques par souci économique. Autre choix de l’auteure : chaque page est issue d’un carnet à spirales ligné de façon à ce que le livre ressemble à un journal intime. Fin des années 60. Karen grandit dans un quartier populaire de Chicago avec sa mère et son grand frère. Farouche, elle consigne dans ce fameux carnet ses états d’âme et les éléments de l’enquête qu’elle conduit sur la mort violente de la voisine du dessus. La petite fille se sent plus proche des monstres qui régalent les films et les comics d’horreur que des gens dits normaux. Se décrit en lycanthrope, tandis que son frère cultive un look de tombeur latino à la Gomez Addams, même si leur mère, métisse irlando-cherokee, n’a rien de latino. Le père, c’est l’homme invisible alors on ne sait pas. Famille unie. La monstruosité envisagée comme reflet de l’humanité est aussi vieille que l’invention des monstres eux-mêmes, et l’ouvrage tire très clairement sur ce ressort fatigué : le monde est plein d’énergumènes bien plus affreux que ceux peuplant l’imaginaire de Karen. Il serait toutefois dommage de s’arrêter à la banalité du dispositif que la gourmandise référentielle finit d’ailleurs par transcender. On saura pourquoi l’enfant se sent à part. Son enquête sur la mort de la voisine lui impose de remuer une boue épaisse appelant des révélations sur d’autres victimes, d’autres culpabilités. On traitera de ces vies cabossées par le biais des rapports sociaux, de l’art et du dessin, de l’amour de la peinture. Et de la folie, de l’acharnement des hommes à engendrer d’authentiques démons. Secrets étouffés, insolubles dilemmes, on dira que les protagonistes tombent de Charybde en Scylla : encore des monstres. Le carnet se referme sur une révélation attendue, mais il en faudra un autre pour tout déméler. De l’avantage de la parcimonie : Monsieur Toussaint Louverture n’a édité que trois bandes dessinées en 14 ans d’existence. Avant celle-ci, Du sang sur les mains de Matt Kindt et Alcoolique de Jonathan Hames et Dean Haspiel, autres ouvrages d’exception.
 Bezimena
Bezimena
Nina Bunjevac – Ici même
Cet autre livre-monstre prend ses distances avec les codes de la bande dessinée traditionnelle en se rapprochant de l’album jeunesse : une page pour le texte, une de pleine illustration. Nina Bunjevac ne destine cependant pas son conte aux enfants malgré une référence directe au Petit chaperon rouge, dont elle brasse le mythe avec celui d’Actéon (ce chasseur transformé en cerf par Diane pour qu’il soit croqué par ses propres chiens après qu’il l’a surprise en train de prendre son bain). L’élégant pointillisme de l’auteure lui permet d’esthétiser, voire d’érotiser la balade d’un prédateur sexuel en adoptant le point de vue de celui-ci… Le cadre devient flou, on impose au lecteur une condition de voyeur tout comme au commencement de la fable, la vieille Bezimena a plongé sans ménagement le visage de la prêtresse dans l’étang pour qu’elle voie et devienne. Par le trouble induit, on pourra se sentir vaguement complice d’un bourreau malade de ses hallucinations et détester cela. Cette sublimation ne rend pourtant pas l’horreur plus policée ni acceptable. Et même si le récit peur exister sans annexe explicative, un propos conclusif lavera toute trace d’ambiguïté en révélant la part cathartique du projet.
 Team Méluche
Team Méluche
Hervé Bourhis – Delcourt
Hervé Bourhis ne respecte rien. Ni la start-up nation, ni son opposition éco-socialiste. Passe à la moulinette les égarements idéologiques et syntaxiques des un.e.s et des autres. Trois jeunes décérébrés macronistes se lancent dans un projèt full-innovation : réaliser l’union entre la République en marche et la France Insoumise. Tant de conneries… Une salutaire jubilation, de quoi préparer la rentrée qui sera chaude et lutter contre l’extrême droite entre les deux tours. Démarrage en fanfare de la nouvelle collection Pataquès chez Delcourt coordonnée par James. Des esprits chagrins ont cru déceler dans ces pages une certaine sympathie pour les grands hommes, “le grognard colérique et la gravure de mode” que l’auteur animerait avec plus de tendresse que leurs fan-clubs respectifs. Il n’est pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni Tribun, prétendent ces pisse-froid, certainement des agent.e.s du vieux monde.
 Sudestada
Sudestada
Juan Sáenz Valiente – Michel Lafon
Le Sudestada est un vent souvent pluvieux qui bat les côtes atlantiques de l’Amérique du sud. Il peut provoquer de fortes inondations dans le delta de Paranà et les lagunes de Buenos Aires. Le dessin de couverture montre un corps maculé de boue coincé sous un arbre arraché. La promesse d’un polar glauque, qui se confirme par la mise en scène de protagonistes aussi antipathiques que peu sexy au premier rang desquels le privé chargé d’enquêter sur la probable relation extraconjugale d’une chorégraphe de renom. Mais aux sombres nuages de la précipitation succédera une éclaircie rédemptrice assez inattendue. Dessin rappelant celui de Prado. Très chouette lecture.
 Les cavaliers de l’apocadispe
Les cavaliers de l’apocadispe
Libon – Dupuis
Ils sont trois collégiens crétins et lâches, faiseurs de bêtises en série, terriblement drôles à force de connerie. Ça parait dans le journal de Spirou, et cette réjouissance œcuménique ravira les écoliers à qui elle s’adresse au premier chef autant que les adultes, qui y trouveront toujours des clins d’œil à eux seuls destinés. Libon est bon. On l’a déjà faite, celle-là ? Mille fois ? Peu importe, il se trouve que Libon est vraiment bon.
 Otto ou l’île miroir
Otto ou l’île miroir
Anne-Margot Ramstein – 2024
Après la Fesse de Guillaume Chauchat, 2024 édite un nouvel ouvrage “ludo-pornographique” empruntant cette fois sa forme aux livres jeunesse. Le nombre de pages est très réduit, elles sont cartonnées et donc rigides. Une seule obsession occupe le récit et sa réalisation formelle : le principe de symétrie. Un homme s’est échoué sur une île où il vivra des moments orgiaques avec son alter-ego et deux sœurs jumelles. Une gémellité d’apparence qui se prolonge sur le plan sensoriel : je ressens ce que ressent mon autre moi. Intéressante perspective. Dans la composition de l’ouvrage, le pli central fait office d’axe de symétrie. Chaque image et son en-tête – un palindrome – se ferme ainsi sur son double presque parfait. Presque. Ce n’est évidemment pas le caractère érotique du livre qui intéresse 2024, bien qu’il épice l’expérience. C’est son abstraction, son élégance graphique. Sucrerie de bibliophile.
 Chaos
Chaos
Stanislas Moussé – Super Loto éditions
Le périple de deux personnages perdus en des temps féroces sur des terres hostiles, accompagnant la débandade de populations entières. Le barbu et la grenouille resteront seuls rescapés après qu’une gigantesque mare de sang aura englouti tout l’espace. C’est en Noir et Blanc, aussi est-il difficile de certifier qu’il s’agit bien de sang. Ajoutons qu’on observe tout cela de très loin, les protagonistes avancent au cœur de pages-paysages comme des figurines au milieu d’un plateau de jeu. On pense alors aux Déserteurs de Christopher Hittinger ou aux dessins foisonnants de Sophie Guerrive. Ce travail anecdotique mais plaisant d’un nouveau venu, Stanislas Moussé, est publié par un éditeur qui n’a pas l’intention de faire fortune et se plaît donc à montrer des travaux qui n’intéressent pas les éditeurs qui font fortune.
The end
Zep – Rue de Sèvres
Est qualifié de sentient tout être disposant à la fois de sensibilité et de la conscience de lui-même. Au regard de cette notion, les anti-spécistes militent pour la fin de la maltraitance et de l’exploitation animales, une libération qu’ils aiment comparer à celle des esclaves. Ceci implique d’arrêter la consommation de viande, de fromage, d’œufs, d’arrêter aussi de porter du cuir ou de la laine. Mais il y a un problème : d’autres gens, dans le sillage ou à côté de Peter Wohlleben, pensent que les végétaux sont eux aussi des êtres sentients, à commencer par les arbres. En attendant que cette information soit scientifiquement confirmée, ce qui permettra sans doute d’étendre le domaine de la libération à l’ensemble des végétaux de la planète, l’être humain ferait bien de ralentir sur les galettes de tofu et s’entraîner à manger de la lumière. On admettra que ce régime alimentaire, certes digeste, reste peu protéiné et dégrade les statistiques en matière de cancer de la peau. Décidément, nous voilà bien. The end adopte les idées de la sentience végétale. Les arbres conspireraient pour la sauvegarde de la planète. Il faut dire qu’on ne l’a pas beaucoup ménagée et que l’espèce humaine a du mal à assumer son bazar environnemental. Que faire ? Ben rien, justement. Continuons de geindre ou nous en foutre, d’autres régleront le problème à notre place. Pas les vaches, qui ruminent, ni les cailloux, qui gèrent le rayon énergie. La forêt. Zep plonge dans l’écologie la plus profonde, celle qui fait un peu flipper, finalement moins par ce qu’elle annonce que pour les ressorts mentaux qu’elle convoque : on peut être pessimiste sur l’état du monde sans pour autant sombrer dans l’holisme et le mysticisme new-age. Mais il est tellement confortable de se dire que Gaïa mère nature a l’œil sur nous (enfin, l’arbre) pour nous punir si nous faisons des bêtises. Ça évite de trop se gratter la tête. Bien construit et agréable à lire, un récit qui énerve par son écologisme neuneu. Spéciale dédicace aux arbres coupés pour la réalisation du livre, ainsi qu’aux agents chimiques utilisés pour en blanchir les pages.
 Des chauves-souris, des singes et des hommes
Des chauves-souris, des singes et des hommes
Paule Constant & Barroux – Gallimard
D’abord ce qui fait tiquer : la forme. Voici un conte illustré se prétendant bande dessinée puisque c’est écrit sur la couverture. Le texte est pourtant autonome et l’image ne raconte rien de plus que les mots – à quelques anecdotiques exceptions près. L’écrivaine, qui revisite là son propre roman éponyme de 2016, n’a manifestement pas su / voulu adapter l’écriture au médium. Le livre mérite pourtant davantage qu’un simple détour. Les couleurs vives de Barroux accentuent par contraste la noirceur d’un texte puissant. Ebola en est le fil, mais Paule Constant veut surtout parler de la damnation de cette Afrique hier soumise aux puissances coloniales, aujourd’hui cible privilégiée et toujours désarmée de l’obscénité néolibérale. Rien ne doit stopper la marchandise. L’obscurantisme fluidifie le transit. Alors les virus suivront les mêmes pistes de latérite que les poubelles de l’occident, les mêmes voies que la camelote destinée aux villageois et les “surplus des consortiums pharmaceutiques” censés les soigner. Une fois n’est pas coutume, la saloperie voyagera peut-être dans l’autre sens. “il n’y a pas d’épidémie, si l’on ne crée pas les conditions de les faire naître”. Récit poétique, cruel et implacable, qui rappelle la capacité de la fiction à raconter le monde aussi bien, parfois mieux que l’essai ou le documentaire.
 La partition de Flintham
La partition de Flintham
Barbara Baldi – Ici même
Comté anglais de Nottinghamshire, 1850. Deux sœurs héritent de leur riche grand-mère. L’arriviste aura l’argent, la fille de devoir gardera le domaine. Ne ménageant pas ses efforts mais sans moyen financier pour l’entretenir, elle devra se résoudre à la désertion, maîtresse devenue servante en s’exilant sur d’autres terres. Un hommage à Jane Austen ou aux sœurs Brontë, qui titille le déterminisme social et l’harmonie patriarcale. Petit côté Cendrillon où le clavecin remplace le soulier de vair. Barbara Baldi apporte une fraîcheur naturaliste au traitement numérique de ses planches. Les images sont remarquables, entre peinture impressionniste et antique photographie sur plaque de verre, qui exacerbent l’ambiance victorienne.
 Football district
Football district
Timothée Ostermann – Fluide glacial
Le titre inquiète. Serait-ce un énième produit dérivé de la coupe du monde ? Que nenni. Timothée Ostermann ne parle pas du foot de la télé, il ne parle même pas de sport. Ou très peu. Ancien titulaire d’un petit club d’une petite ville d’Alsace, il parle de jeu, de sociabilités, d’avant-match, d’après-match, et affirme son attachement à la vie des gens ordinaires qui fait rarement sujet littéraire, portant sur eux un regard affectueux sans condescendance ni fausse indulgence bourgeoise. Plus Rochier que Rabaté, qui malaxent un matériau similaire : Rabaté écrit des fictions, Rochier et Ostermann brodent sur leur propre existence. Enfin Ostermann, qui bosse aussi pour So foot, n’en est qu’à son deuxième ouvrage, aussi est-il trop tôt pour tirer de grandes lignes. À la différence de Rochier, il entre dans les détails, aime contextualiser. Voyage en tête de gondole, qui racontait ses aventures professionnelles en supermarché, était déjà très réussi. Football district parlera aux amateurs (et amatrices) qui ont eu l’honneur de fouler une pelouse le dimanche, il instruira les autres, et tout le monde passera un bon moment sans avoir jamais l’impression de rire aux dépens.

