“Il n’y a probablement pas d’enfer pour les auteurs dans le monde d’après, les éditeurs et les critiques les font suffisamment souffrir dans celui-ci” (Christian N. Bovee)
 Femme rebelle, l’histoire de Margaret Sanger
Femme rebelle, l’histoire de Margaret Sanger
Peter Bagge – Nada
Biographie de la militante féministe à qui nous devons le Planning familial. La construction par strates chronologiques et sauts temporels abrupts semble peu compatible avec une lecture linéaire, d’autant que Bagge a rédigé, en les plaçant en fin d’ouvrage, des notes apportant de précieux compléments à ses mises en situation. Si cette structure fragilise la lisibilité, elle permet au récit de se concentrer sur l’essentiel et de maintenir un rythme accordé à l’hyperactivité de Sanger. Bagge évoque sa vie privée et son action politique, jamais déconnectées l’une de l’autre, les rencontres déterminantes (Emma Goldman, Havelock Ellis…), retient les moments-clef sans statufier les protagonistes. Il contextualise l’ambiguïté de la militante dont les détracteurs (activistes pro-life et autres, voir plus bas) continuent de pointer l’eugénisme, le racisme, une sympathie présumée pour le Ku Klux Klan. Son dessin bubble-gum ne vise ni la ressemblance ni la rigueur du détail, distille sans fioriture la quintessence d’une vie hors norme : c’est la grande réussite d’un livre qui donne envie d’en savoir davantage. Sur le rapport idéologique au sujet, quelques précisions s’imposent. Chroniqueur régulier au magazine Reason dont le sous-titre est “free minds & free markets”, Peter Bagge affiche un goût affirmé pour les thèses libertariennes. Lire (éventuellement) Tous des idiots sauf moi, une recension de ses chroniques journalistiques publiée en 2010 par Delcourt. Le libertarianisme est cette philosophie politique qui confond l’être et le propriétaire, conchie l’État et tout ce qui s’y rapporte au motif qu’aucune institution ne doit venir interférer entre l’individu et ses petites affaires ni limiter les bénéfices que chacun-e peut tirer de l’exploitation de ses biens, de ses terres, de sa multinationale, ou pour celle qui ne possède rien, de ses propres organes (voir Chester Brown et les 27 prostituées). Pas de commun, la redistribution des richesses ne se conçoit que via le mécénat ou les bonnes œuvres. Sur le plan individuel et social, cette idéologie exige évidemment la plus grande “liberté” et c’est ici que se rencontrent la maison d’édition libertaire (Nada), la militante réputée anarchiste et l’auteur. Un malentendu persistant rapproche les termes libertarien et libertaire qui traduisent tous deux le mot libertarian. Cette apologie de la liberté sous-tend des modes d’organisation sociale antagonistes, mais il n’est pas toujours évident d’échapper à la confusion. Dans une interview au magazine Reason rapportée par l’éditeur canadien Drawn & Quarterly, Bagge explique : “en visant à rendre disponible et améliorer les techniques de contrôle des naissances, Sanger a complètement bouleversé la civilisation occidentale, et pour le meilleur. Donner aux gens le choix d’être parents ou non est la chose la plus [libertarian] qui soit arrivée aux êtres humains au cours des 1500 dernières années.” Un point de vue, disons, particulier, quand on sait que le Planning familial, comme structure largement subventionnée, est loin de faire l’unanimité chez les libertariens qui exècrent fondamentalement tout ce qui relève de l’État-providence… Tirer les fils de la confusion et tenter de débrouiller le paradoxe permet de prolonger le plaisir de cette lecture passionnante, dense et sans temps mort.
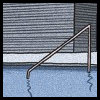 L’aimant
L’aimant
Lucas Harari – Sarbacane
Ouvrage de très élégante facture, par un nouveau venu s’aventurant dans des espaces formels assez surprenants, ne serait-ce que parce qu’il exclut la couleur blanche de ses compositions. Harari a supprimé les gouttières entre les cases, travaille chaque planche jusqu’à saturation de la bichromie rouge-bleue annoncée en couverture. Dédié aux bains du complexe thermal de Vals, en Suisse, un bunker conçu dans les années 90 par l’architecte Peter Zumthor, L’aimant n’est jamais autant réussi que dans ses pauses contemplatives qui n’ont, hélas, pas toujours le temps d’installer leurs effets. L’auteur ne fait pas suffisamment confiance en la singularité du lieu dont il a pourtant estimé le potentiel fantastique, ni dans le pouvoir de la suggestion, se focalise sur la cohérence du récit au détriment de son étrangeté. Il n’empêche que ce livre est une des belles surprises de la rentrée.
 Kérosène
Kérosène
Piero Macola & Alain Bujak – Futuropolis
Reportage dans un camp manouche de Mont-de Marsan. Deuxième collaboration d’Alain Bujak (récit, photos) et Piero Macola (dessin) après Le tirailleur. Les auteurs questionnent une fois encore le déplacement, géographique et mental, de personnes frappées d’ “étrangeté” où qu’elles se trouvent. Les ambres de Macola servent finement le documentaire, les photos de Bujak relèvent beauté et joie de vivre, images qu’on pourra trouver trop esthétisantes mais dont on appréciera qu’elles tiennent à distance celles des “Lopez vs Lopez” qui, il y a quelques années, avaient infesté les réseaux sociaux. Jamais les gitans n’avaient suscité autant d’intérêt : dommage qu’il se fût limité aux railleries et au mépris de classe, le b.a.-ba du racisme. Kérosène, loin de ce folklore d’écran, s’intéresse d’abord aux conditions de vie dans le camp du rond, puis au déménagement marquant peut-être l’étape ultime de la sédentarisation. On sait que le sujet ne fait pas la qualité du livre mais celui-ci est tout à fait recommandable. À propos des manouches, empruntant une voie très différente, lire aussi Crache trois fois de Davide Reviati — voir plus bas.
 La vallée du diable
La vallée du diable
Anthony Pastor – Casterman
Suite du périple des compagnons qui avaient trouvé un bateau en partance vers les terres australes après une traversée de l’Hexagone depuis leur Savoie natale (in Le sentier des reines). Depuis son passage chez Casterman, Anthony Pastor qui jusque-là évitait de trop contextualiser ses histoires — une Amérique frontalière, des époques indéterminées — travaille des territoires précis et documentés. Le sentier des reines évoque la désertification des villages après la première guerre mondiale, La vallée du diable la situation coloniale en Nouvelle Calédonie dans les années vingt. Si l’environnement évolue, la bienveillance de l’auteur persiste, qui répugne toujours à mettre en scène de parfaits salopards et évite le sordide dont d’autres font leur sel. Dans un monde tiraillé entre le bien et le mal, les femmes conserveront le beau rôle, fortes et justes, tempérant la lâcheté des hommes, leur goût du pouvoir, leurs rivalités destructrices. Le récit se construit par cercles concentriques autour d’une tempête qui s’annonce, les situations sont révélées, les tensions se cristallisent jusqu’au cataclysme et la résolution finale. Travail des textures et des couleurs soigné : aux tons hivernaux du précédent volume succède une palette aveuglante caractérisant la luminosité tropicale, avant que la tempête ne fasse tout basculer dans l’obscurité. Les lecteurs auront du mal à envisager que le dessin soit seulement numérique : la tablette graphique est, pour Anthony Pastor, un outil maîtrisé au service d’un trait ignorant l’infaillibilité numérique. Sur un registre plus tragique, aussi plus balisé (colons versus indigènes), cette aventure (conclusive ?) est aussi réussie que la précédente.
 Prison pit
Prison pit
Johnny Ryan – Huber
Deuxième ouvrage publié par les jeunes éditions Huber après le Rocky de Martin Kellerman. Johnny Ryan est un auteur de comics underground assez peu connu en France malgré des collaborations avec Dave Cooper ou Peter Bagge. La maison Humeurs avait sorti Comic book holocaust en feu d’artifice conclusif de ses activités (portée disparue depuis 2009), un petit ouvrage méchant dans lequel Ryan outrageait tous les grands titres de la BD américaine ou européenne. Cracra mais savoureux. Au début de Prison pit, un bonhomme patibulaire est jeté au fond d’un trou vers une lande désertique servant de prison. Un désert est assez peu contraignant question décors, Ryan peut donc se concentrer sur l’essentiel : la danse des brutes, les variations sur le thème. “Mon territoire va du tas de crânes jusqu’aux têtes sur les piques et jusqu’à la mare de sang”, avertit une espèce de Conan le barbare. Ensuite, lui et l’autre patibulaire se foutent sur la gueule jusqu’à ce que tripaille surgisse. Les personnages en noir et blanc tiennent davantage des super-héros de Daniel Johnston que de l’académisme photoshopé des comics de masse. Quand ils parlent (rarement), ils utilisent le langage familier des slackers. C’est crétin et drôle parce que parfaitement assumé. Mécanique répétitive adoptant le canon des jeux vidéo de combat : le héros doit affronter en permanence de nouveaux adversaires. Il les étripe, les croque, de leurs entrailles fumantes et mutantes s’extirpe un boss de niveau 2, nouvelle baston, il y a du sang et de la merde partout, pas de temps à perdre, une autre menace apparaît. Le lecteur épuisé sort un instant du récit pour reprendre son souffle et estimer le nombre de pages restantes ; se rend compte avec une certaine perplexité qu’il n’en est qu’à la 125ème et qu’il en reste autant pour achever ce, heu, premier tome… Malgré le capital sympathie régressive dont bénéficie Ryan, ça risque de faire un peu long.
Alexandrin ou l’art de faire des vers à pied
Alain Kokor et Pascal Rabaté – Futuropolis
Kokor aime distordre le réel tandis que Rabaté l’aborde frontalement, par la banalité, l’ordinaire de vies assez peu flamboyantes. Les travaux respectifs de ces poètes humanistes, le premier un peu lunaire, le second plus terrien, explorant les rapports sociaux par des voies divergentes, témoignent du potentiel sensible de la bande dessinée. Leur rencontre présageait le meilleur. Un clochard céleste va de porte en porte pour vendre ses poèmes, bientôt secondé par un enfant fugueur qu’il initiera au vagabondage et à la rime. La rime, voilà le problème au cœur même du dispositif. Alexandrin ne s’exprime que par alexandrins. Ce parti pris scénaristique fait sourire puis agace, carcan bridant le rythme et la qualité des échanges. Car les vers de mirliton amidonnent la poésie, lui ôtent toute souplesse, finissent par l’étouffer. Le récit reprend de l’altitude dans son dernier tiers quand Alexandrin perd ses interlocuteurs et sombre dans la mélancolie, grâce à de nombreuses plages silencieuses jouant du narratif et du contemplatif. Inspirées, elles suggèrent un chemin plus buissonnier, plus convaincant, si les deux auteurs s’étaient — paradoxalement — affranchis du système qui a fondé leur collaboration.
 Le voyageur
Le voyageur
Koren Shadmi – Ici même
Un étrange voyageur porte sur ses épaules le “fardeau de l’éternité” et un sac plein de poussière. il traversera les époques jusqu’à l’extinction des espèces, accompagnant une lente mais sûre apocalypse. Il a vu le monde s’assécher à cause de l’incurie humaine, la biodiversité disparaître, l’air devenir irrespirable et les êtres s’entre-détruire. Shadmi revient à ses préoccupations existentielles après une parenthèse autofictionnelle (Love addict chez la même éditrice, chroniquée ici). Un constat sinistre et sans issue, qui pointe l’absurdité de la survie individuelle face au délabrement collectif.
 Mon Lapin Quotidien n°1 et 2
Mon Lapin Quotidien n°1 et 2
Collectif – L’Association
Pandora n°3
Collectif – Casterman
 Nicole n°6
Nicole n°6
Collectif – Cornélius
Trois revues pour votre été. La “revue d’éditeur” qu’on trouve en librairie mais pas en kiosque est une espèce traditionnellement peu courue par le chaland. Dommage. Dans le meilleur des cas, c’est là qu’on expérimente et qu’on taquine l’avant-garde… Avant-garde ou non, les jeunes pousses y font leurs gammes avant un premier livre publié en leur nom propre. Rémanence du fanzine, la revue agglomère les travaux de compagnons de route, camarades d’école ou d’atelier. Mais toutes les revues d’éditeur ne caractérisent pas la rémanence du fanzine et n’invitent pas les jeunes pousses, comme nous le verrons plus bas. La fréquence de publication est faible, voire aléatoire. La revue d’éditeur peut être un almanach, rarement un mensuel. Elle perd sa singularité quand elle se contente d’accumuler des récits linéaires à butiner sur la plage : les kiosques sont remplis de périodiques dont c’est la vocation première.
Menu, David B., Killoffer, Dupuy & Berberian et Fabio sont dans une revue. Pas celle à laquelle vous pensiez peut-être. Pandora n’est pas Lapin et Casterman n’est pas L’Association. D’ailleurs, Pandora ratisse d’autres plates-bandes que celles déjà défrichées par L’Association. La “nouvelle bande dessinée” des années 90 a ensemencé tout le paysage, la chair est devenue bien juteuse. Au début le goût était bizarre mais il y a des gens pour aimer ça, alors : lopins préemptés, ferme-usine installée. Production réputée exigeante, industrielle quand même. On tapisse les abris-bus d’affiches publicitaires, on arrose les rédactions de services de presse. L’objet est moche et son obsolescence programmée puisque grosse production ou pas, la revue de librairie reste dédaignée par un lectorat peu sensible à l’épineuse question du retour sur investissement. Giardino, Loustal, Spiegelman, Pellejero… Pandora ressemble à un supergroupe de rock ventripotent. Manque globalement d’envie. Rejoue des partitions connues, pense à autre chose, prend la monnaie. Quelques fulgurances méritent le détour vu le talent des auteurs engagés, et vous l’achèterez pour que nos copains continuent d’y écouler leurs planches moyennant rémunération, merci pour eux. Ah oui : une précision à l’usage des lecteurs allergiques. Ce troisième numéro de Pandora contient quelques traces résiduelles d’œstrogène. Sur 38 auteurs on peut en effet comptabiliser 2 autrices, ce qui nous fait dans les 5%. Souvenons-nous alors, en ricanant, que Pandore fut le nom de la première femme dans la mythologie grecque.
Pendant ce temps, l’authentique Lapin renaît de ses cendres par une énième formule, pas la moins intéressante sur le fond et la forme. Broadsheet (format XXL du Frankfurter Allgemeine Zeitung) sur papier recyclé Cyclus 100 grammes. Stylé. Texte et dessins imbriqués ou faisant chambre à part. MLQ persifle et poétise. MLQ pour Mon Lapin Quotidien, qui comme son nom l’indique est un trimestriel. Il paraît que l’acronyme fait beaucoup rire Killoffer. Pour être précis, MLQ réalise l’hybridation de Lapin et du regretté Tigre de Lætitia Bianchi et Raphaël Meltz (ce dernier au sommaire de MLQ 1 et 2, comme d’autres plumes du félin tel Eric Chevillard). MLQ ressemble au Tigre dans sa façon d’associer librement auteurs de bandes dessinées, écrivains et journalistes, et dans sa critique “préférant l’ironie à la diatribe”. MLQ diffère du Tigre car ne propose pas de reportage et pratique la promotion, vitrine des publications de L’Association. Ce n’est pas l’aspect le plus intéressant de cet épatant projet. Quelque part entre le Canard enchaîné, rapport à la satire et au bordel typographique, et Le Trombone illustré. À savourer à plusieurs en faisant circuler, c’est encore meilleur.
Nicole enfin. Pour rappel : Les Requins marteaux (Franky) et Cornélius (Nicole) s’accordèrent sur le va-et-vient d’une publication semestrielle. Franky a depuis lâché l’affaire mais Nicole persiste. Par la juxtaposition de récits courts en bandes dessinées, elle bêche un jardin qui ressemble, toutes proportions promotionnelles gardées, à celui de Pandora. Au point que l’une s’est appropriée sans vergogne un texte de présentation de l’autre. On ne peut pas dire que Cornélius, 26 ans au compteur, incarne l’avant-garde. Si la maison n’a jamais dédaigné la création, elle s’est quand même bien focalisée sur le patrimoine et les traductions. Mais Nicole a la curiosité affûtée (Pauline Hébert, Renaud Thomas, Oriane Lassus, Jérôme Dubois, Delphine Panique) et le goût sûr. Accessoirement le même que celui de ses voisines : Hugues Micol est dans Pandora et Nicole, mais pas dans MLQ. Trondheim est dans Nicole et MLQ, mais pas dans Pandora. David B. et Killoffer sont dans Pandora et MLQ, mais pas dans ce numéro de Nicole. On remarquera que personne ne fait coup triple. Sans doute la conséquence de cette loi sur la modernisation de la narration graphique qui limite le cumul de l’entre-soi. Pagination et prix similaires, même famille d’auteurs — à ceci près que Casterman ratisse aussi le mainstream, Pandora ou Nicole, comment choisir ? Pourquoi choisir ? Comment se fait-il que la seconde tienne le cap de la revue de caractère quand la première ressemble davantage à un catalogue ? Nicole a le mojo. Ce truc qui donne de la cohérence à l’accumulation indépendamment de la force du chéquier. Aussi une gouaille qui rythme avec bonheur l’envie de transmettre, totalement étrangère à Pandora.
 Museum tomes 1 et 2
Museum tomes 1 et 2
Tomoe Ryôsuke – Pika
La série sera achevée au bout de trois épisodes seulement, une motivation comme une autre pour s’emparer d’un manga. Choix pertinent si on aime les thrillers bien glauques façon Seven : des meurtres en série plus répugnants les uns que les autres, un enquêteur directement impliqué dans les délires du tueur à masque de grenouille, de fortes chances que le récit s’achève dans l’abjection absolue. Bon appétit.
Gang of 4
Winshluss – Les Requins marteaux / Frac Aquitaine
Bande dessinée conceptuelle. Adopte la forme du comic-book pour présenter ce qui semble être un extrait d’une aventure au long cours : la traque de quatre jeunes gens par une milice d’abrutis. Winshluss s’auto-caricature sur 20 pesantes pages. On comprend le concept à la 21ème, qui doit se lire comme un cartel dans une salle d’exposition : “la FRAC Aquitaine et les Requins marteaux invitent un dessinateur à choisir une œuvre de la collection [du Fonds régional d’art contemporain] en préambule à l’écriture d’une bande dessinée. Cette coédition, aux multiples contours, déploie l’imaginaire contenu dans les œuvres tout en élargissant le regard sur l’art contemporain en général”. Une photo de Diane Arbus est l’œuvre élue. Winshluss intitule son élargissement Gang of four en souvenir des années punk où il avait de l’inspiration.
 La longue marche des éléphants
La longue marche des éléphants
Troubs & Nicolas Dumontheuil – Futuropolis
Reportage en bande dessinée. Troubs est coutumier du voyage à deux (et du voyage tout court !), on se souvient de ses vagabondages avec Baudoin pour L’Association, Viva la vida en 2011 et Le goût de la terre en 2013. Les artistes n’ont dans le cas présent pas travaillé ensemble, se sont à peine croisés pour un passage de relais. Dumontheuil, d’abord, a suivi la caravane organisée en 2015 à travers le Laos afin de sensibiliser les villages à la préservation de l’éléphant. Troubs est arrivé à l’issue de cette longue marche pour un séjour au centre de conservation de Sayaboury. Le premier, fin observateur, s’intéresse à la socialisation de l’animal avec l’être humain et s’attache à l’anecdote, en distillant l’humour lunaire dont il est coutumier dans ses ouvrages plus personnels. Le second pousse la réflexion, et parce qu’il se retrouve à un endroit où l’éléphant évolue en quasi-liberté, focalise son attention sur l’animal en réduisant parfois son dessin jusqu’à l’abstraction. Tous deux montrent, de leurs points de vue juxtaposés, comment le capitalisme s’est imposé une fois encore à une société traditionnelle, comment l’éléphant est devenu acteur de la déforestation dont il est aussi l’une des premières victimes, abaissé avec son cornac à la condition de soutier de l’industrie forestière. Un travail de commande mené de façon remarquable.
 Crache trois fois
Crache trois fois
Davide Reviati – Ici même
Pavé aussi impressionnant que celui précédemment servi par le même auteur, l’adjectif valant pour le format mais aussi le dessin et l’ambition narrative. Six ans se sont écoulés depuis la sortie d’État de veille (Casterman) qui racontait le déterminisme social à l’ombre d’une usine pétrochimique. Dans ce nouveau livre encore nourri d’une histoire intime, Reviati évoque plus précisément son enfance. Puisque le narrateur ne se prénomme pas Davide, on prétendra qu’il s’agit d’une fiction en laissant résonner les mots introduisant Souvenir d’une journée parfaite (voir ci-dessous) : “Lorsqu’on cherche à créer de pures fictions, on se raccroche à ce qui nous a fondé, à ce qui nous est arrivé. Au fond, les récits inventés sont encore notre vie intime”. Trois garçons se rencontrent dans une banlieue modeste de Ravenne, ne se quittent plus jusqu’à fréquenter le même lycée technique, pas franchement convaincus d’être engagés sur les bons rails. Ils préfèrent fouiller les champs avoisinants dont le labour révèle d’étranges sédiments, bientôt picoler, jouer au billard, aller en boîte à Rimini, faire des conneries : un programme d’ados. Subtilement mise en images, l’histoire resterait somme toute banale sans quelques intrus surgissant pour les lecteurs comme pour les trois copains, sans être attendus mais en réclamant de l’attention. Ce sont les tziganes qui vivent dans une ferme abandonnée pas très loin de là. Crache trois fois est un livre sur l’incommunicabilité et la distance que ni les protagonistes, ni même l’auteur avec le recul et sa connaissance du sujet, ne réussiront à réduire. Parce que l’attirance réciproque des Gadjé et des Sinté est nouée de perversion, de répulsion, de suspicion, de xénophobie, infâme brouet. S’il s’agit d’un travail cathartique fondé sur une vieille culpabilité, Reviati échoue malgré l’attention portée, malgré ces pages documentaires sur les persécutions nazies et autres — le bourreau change mais la persécution subsiste — qui viennent perturber la construction savante du récit. Le mystère perdure et le pardon n’est pas de mise puisqu’il n’y a aucune exigence en la matière. Paradoxalement ou pas, c’est bien ce constat d’échec qui fait la réussite du livre sur le fond. Entre la rencontre initiale et de furtives retrouvailles bien des années plus tard, 350 pages sont passées et rien n’a changé, le malaise reste de mise. Aucune amitié ne s’est forgée, seule la conscience a mûri. “Une parole c’est une parole” dit Maurizio le gitan. “C’est ce qui compte le plus. Mais il y a un miroir entre les Gadgé et moi. En réalité, des Sinté il y en a deux en moi, un pour les Gadjé et un pour les Sinté. Parce qu’il y a ce miroir. Et je ne tiens pas toujours ma parole avec les Gadjé. Parce qu’il y a un miroir”.
 Souvenir d’une journée parfaite
Souvenir d’une journée parfaite
Dominique Goblet – FRMK
Réédition de l’œuvre fondant le triptyque autobiographique de Dominique Goblet. Les travaux le composant ont souvent été conduits en parallèle. La réalisation de Chronographie (L’Association, 2010), qui explore la relation mère-fille par la seule accumulation de portraits réciproques, s’étale sur dix ans. Douze ont été nécessaires pour achever Faire semblant c’est mentir (L’association, 2007), la pièce centrale, qui confronte la tendresse d’un couple au traumatisme d’une enfance mal-aimée. Le premier livre publié fut donc ce Souvenir lié au père, en 2000 par Fréon (un des deux ancêtres du Frémok). Longtemps épuisé, enfin lu. Au cimetière, sur un mur constellé de plaques métalliques, l’auteure cherche en vain le nom de son père parmi des centaines d’autres. Elle choisit un patronyme quelconque et imagine quelques bribes de la vie associée, de façon à honorer son rendez-vous malgré tout. La part autobiographique de la fiction sera révélée en fin d’ouvrage. Les deux personnages, celui dont le patronyme ne se rapporte à aucune vie connue et celui dont la vie est connue mais dont on ne retrouve pas le patronyme, se complètent jusque dans la représentation, puisqu’on ne verra jamais l’image de la narratrice ni celle de son père, et que seuls figureront les protagonistes imaginaires. Cette réédition essentielle rappelle, si nécessaire, à quel point Dominique Goblet influence le dessin européen depuis vingt ans, sans jamais cesser d’explorer son art.
 Papa Zoglu
Papa Zoglu
Simon Spruyt – Même pas mal
Le bruxellois Simon Spruyt est arrivé en France en 2014 via SGF, une satire du monde de l’édition très inspirée de Winshluss. Il revient chez Même pas mal avec ce Papa Zoglu virtuose qui emprunte sa forme aux peintures médiévales et aux livres d’heures, une très aimable fable queer placée sous la protection des ongulés.
 Longs cheveux roux
Longs cheveux roux
Meags Fitzgerald – Pow Pow
Autre récit autobiographique. Celui-ci raconte l’éveil d’une jeune femme aux sentiments et à la sexualité. Premières règles, premiers contacts, tergiversations capillaires. Découverte et acceptation de soi au temps des mutations hormonales, la chanson est connue et transcende la personnalité, le contexte et le chemin. Il se trouve que Meags Fitzegerald met sa bisexualité au centre du dispositif. Grandissant dans un milieu bienveillant, ses questionnements existentiels restent affranchis de toute forme d’ostracisation en retour (c’est en tout cas ce qu’elle choisit de montrer), et confinent à une certaine banalité. Une façon, peut-être, de viser l’universel. Propos pudique, dessin chaleureux.
Scènes de la vie de banlieue
Caza – Les Humanoïdes associés
Compilation d’histoires fantastico-humoristiques publiées dans Pilote au cours des années 70. Spécialisé dans la SF — bandes dessinées ou couvertures de romans, Caza est souvent rapproché des deux géants de sa génération, Druillet et Moebius. Il a moins marqué l’époque à cause d’un trait plus impersonnel, peinant à s’affranchir du support photographique et des tics graphiques alors en vigueur. Ces scènes de la vie de banlieue ne manquent pourtant pas d’intérêt. Il est amusant de constater que l’intégrale est publiée quelques semaines après Soft city, de Pushwagner (Inculte) qui raconte différemment la même aliénation. L’avatar du dessinateur hippie affronte celui du français moyen sur son territoire, la banlieue HLM et ses perpendiculaires de béton. “Terrorisme vert”, couleurs criardes (cette couverture à gerber !), psychédélisme et vaudou. Daté, relu avec un certain plaisir. Reste à savoir si la découverte de ce travail en 2017 peut procurer un plaisir analogue.
Les Captainz
Yoann et Olivier Texier – Le Lombard
Les super-héros déglingués ont imposé un nouveau genre dont la grammaire a submergé les comics les plus courus. L’ironie et le second degré dominent et les imbéciles paradent en slip. Avec le dessin dynamique de Yoann et un scénario de l’excellent Olivier Texier, expert en déglingue, l’affiche était alléchante. Hélas, le cahier des charges imposait sans doute que l’album reste accessible à “tout public”, ce fameux tout-public dont on ne se sait pas grand-chose sinon qu’il affadit tout ce qu’il labellise.

