« Pierre s’est dit : mais pourquoi n’écrirais-je pas un ensemble de phrases constituant une œuvre et qui, une fois terminé, formerait un assemblage de feuilles portant mon texte, lesquelles feuilles seraient réunies et collées en un volume broché et attrayant ? Ce sera peut-être difficile, mais ça vaut la peine d’essayer » (Georges Kolebka)
L’esprit du 11 janvier
Lehman & Gess – Delcourt
Il est des livres qu’on préférerait ne pas ouvrir. Retour direct à l’envoyeur avec le bénéfice du doute. Hélas, on se retrouve à les lire pour une raison ou une autre, puis on les chronique par accablement.
L’éditeur annonce : “C’est à une rêverie que nous convient Serge Lehman et Gess dans ce retour sur les attentats qui ont frappé la France. Mais aussi une enquête sur les petits faits étranges qui ont scandé la tragédie : coïncidences, thèmes qui se répondent, personnages dédoublés, signes du ciel, etc. Les auteurs explorent, par jeu autant que par refus de céder au désespoir, la possibilité d’un miracle que personne n’aurait vu”.
L’émotion avance. Besoin de « miracles ».
La magie ne réapparaît dans la sphère sociale que parce que la raison recule. Devant son incapacité à appréhender l’événement et ses conséquences, Lehman s’en remet aux signes (par exemple : le pigeon qui a visé l’épaule de Hollande le jour de la manif) et ce faisant, révèle une certaine proximité mentale avec tous les fous de dieu et conspirationnistes de la zone, y compris ceux qui sont à la source de son chagrin. L’abandon de la pensée critique nourrit la croyance en des puissances occultes qui tirent les ficelles (insister sur ces coïncidences-qui-n’en-seraient-pas ou déplorer l’omnipotence des Illuminati, c’est un peu la même came). Pour se distinguer, Lehman noie son baratin dans la soupe républicaine car il connaît son éducation civique par cœur, et voit dans les grands mouvements populaires qui ont suivi le massacre de Charlie Hebdo l’avènement d’une « religion civile ». Tous les mots-clé y passent : esprit, communion, extase, passion, sacré. Personne ne lui a rien demandé et en prétendant embrasser l’universel, il ne parle finalement que de sa propre crise de foi.
Certains disposent de tribunes d’envergure pour exprimer leur sidération. Éditorialistes, experts multi-cartes familiers des studios radio et plateaux télé. Le petit peuple, à qui on tend parfois la perche pour un micro-trottoir de 12 secondes, leur prête aimablement une oreille attentive, sachant qu’il a en fait peu de chance d’échapper au matraquage médiatique. Sur le 7 janvier, les notables de l’information ont fait de leur impuissance un spectacle en débitant de la salade au kilomètre. On croyait en avoir fini mais non : le biais change, la glose continue. « Charlie n’est pas mort : telle est la signification du signe. Les frères Kouachi ont échoué », assène Lheman en analysant le caca du pigeon. Où en serait-on s’ils avaient réussi ? À l’état d’urgence permanent ? La foi peut aussi être mauvaise, en témoigne cette tirade relative à la première Une de Luz après l’attentat (« Tout est pardonné ») : « De nombreux médias ont refusé de montrer cette Une au motif qu’elle était offensante. Partout dans le monde, pas seulement dans les pays musulmans. Des vidéos de décapitations, des photos de corps suppliciés, des appels au meurtre de masse, rien de tout ça ne pose problème… Mais l’image d’un homme qui pleure et qui pardonne, c’est trop dangereux ». Rien de tout ça ne pose problème, bien sûr. N’importe quelle exagération, du moment que ça claque.
Bref. Ce prêchi-prêcha spirituo-laïcard ne fait qu’ajouter à la confusion ambiante. L’esprit du 11 janvier a pris ses distances avec l’esprit critique. Et les dessins de Gess, qui s’est globalement contenté d’ânonner les images diffusées en boucle par TF1 ou BFMTV, n’arrangent pas les choses.
 Cruelle
Cruelle
Florence Dupré La Tour – Dargaud
Premier volet d’un « triptyque autobiographique sur l’enfance ». Derrière ce titre qui fleure bon la culpabilité judéo-chrétienne (la petite Florence n’est pas si cruelle, elle a surtout le sentiment de l’être), un récit d’apprentissage. Sa famille aisée et cul-bénie vit loin de la ville en quasi-autarcie. Son papa travaille beaucoup, sa maman est souvent enceinte. « Le christ est le chef de tout homme et l’homme est le chef de la femme », dit monsieur le curé dans son sermon dominical. Petite Florence n’est gênée par le patriarcat que parce qu’on lui a fait comprendre qu’elle n’est pas du bon genre. Elle inflige quelques châtiments à des animaux désobéissants. La domination, c’est super quand on domine, mais parfois on fait du mal alors c’est mal. Elle regrette peut-être. Réactions contradictoires, l’ambiguïté interroge l’enfant qui entretient un rapport binaire au monde : blanc ou noir, bien ou mal, tendresse ou cruauté, mimétisme ou rejet. Garçon ou fille. Après mûre réflexion, peut-être la tangente : « je ne suis pas un être humain et je n’ai aucune envie de le devenir ». Mais le rapport au monde évolue et de toute façon, ça ne se passe jamais comme prévu. Sur le registre intime, un nettoyage à sec avec comme solvant l’ironie tranchante dont l’auteure est coutumière. Vivement le deuxième volet.
 Capitaine Mulet
Capitaine Mulet
Sophie Guerrive – 2024
En l’an 1457, des collègues de Gutenberg réalisèrent un ouvrage connu aujourd’hui sous le nom de Psautier de Mayence, premier incunable à la fois imprimé, daté et signé. Une année charnière en quelque sorte, que choisit Sophie Guerrive pour situer les folles aventures de son capitaine. Mais elle reste attachée aux formes syntaxiques et graphiques traditionnellement associées au Moyen-âge, en désapprenant par exemple les règles de perspective (quand l’importance du personnage primait sur sa position dans l’espace). Envoyé par le Roy se faire voir chez les Atlantes, Célestin Mulet porte haut la devise “Honneur et profit”. Ce cocu imbécile en quête de vengeances à géométrie variable sera successivement navigateur, roi auto-proclamé, vagabond, ladre, croisé, médecin et sorcier, avant de redevenir seigneur de son royaume imaginaire. Capitaine Mulet est publié dans le même format que Canne de fer et Lucifer, un livre de Léon Maret sorti en 2012. Sans doute une évidence éditoriale pour 2024, tant l’approche des auteurs est voisine : jeunes gens arrivant après la querelle des anciens et des modernes, utilisant librement leur trait pour des récits d’aventures sincères et décalés (dans le sens où les amateurs de bandes dessinées épiques sont habitués à un académisme qu’ils ne trouveront pas ici), témoignant d’une forte personnalité. Dans les deux cas, l’humour omniprésent évite l’écueil des références à la pop culture autant que les blagues potaches, et le récit au long cours ne perd jamais sa trajectoire. Un divertissement de caractère.
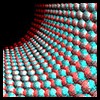 Frank in the 3rd dimension
Frank in the 3rd dimension
Jim Woodring & Charles Barnard – Fantagraphics
Avec Frank, dont les différentes aventures (ce mot là à défaut d’un autre) sont publiées en France chez L’Association, Woodring développe un univers de cartoon halluciné, à la fois cauchemardesque et insouciant. Ses monstres n’effraieront sans doute pas les plus sensibles des lecteurs, et les personnages qui se font parfois éviscérer ne tardent jamais à reprendre vie. Présenté à l’italienne, ce livre aux pages cartonnées propose 27 tableaux auxquels un spécialiste de la 3D anaglyphe, Charles Barnrad, s’est appliqué à donner de la profondeur. Il explique que le dessin original est destiné à l’œil gauche, qu’il a dû superposer entre 200 et 400 calques sous son logiciel de traitement d’images pour décaler les éléments d’un côté ou l’autre et créer l’effet de relief. La page de garde vous entraîne avec Frank dans un tunnel en forme d’entonnoir gravitationnel. Laissez vous emporter : le même tunnel vous expulsera juste avant que vous ne refermiez le livre, une grosse boule rigolote à vos trousses. Un régal.
 Dans les pins, 5 ballades meurtrières
Dans les pins, 5 ballades meurtrières
Erik Kriek – Actes sud / L’An 2
Adaptations de chansons noires et édifiantes, classiques de la musique populaire dite “des Appalaches” dont les origines sont à chercher du côté des îles britanniques. « Cela donne un bon reflet de l’Amérique du XIXe siècle, où les violences par armes et le moralisme d’obédience religieuse s’équilibraient mutuellement », écrit le journaliste Jan Donkers en postface. Qui tue par l’épée meurt par l’épée (ou la corde). La tradition s’est imposée outre-Atlantique à toutes les formes d’expression y compris la bande dessinée, voilà pourquoi ces histoires ont un air de déjà vu, renvoyant par exemple à celles publiées jadis dans les magazines Eerie ou Creepy, le fantastique et les ricanements horrifiques en moins. Nous connaissons le néerlandais Erik Kriek pour les héros costumés parodiques qu’il a créés il y a plus de vingt ans dans Gutsman comics : sa muse est décidément américaine. Les auteurs des cinq chansons qu’il interprète ici ne sont pas directement crédités, mais sachant que les titres et versions ont largement évolué au fil du temps, il n’est pas toujours facile de remonter à la source (Donkers s’y emploie à la fin du livre). Arrêtons nous un instant sur la dernière friandise, révision d’une ballade originaire des terres australes. Where the wild roses grow a été écrite par Nick Cave pour Kylie Minogue et figure sur un album opportunément intitulé Murder ballads. Mise en abyme, beau va-et-vient entre continents qui témoigne aussi des courants migratoires et culturels : la chanson de Nick Cave est elle-même inspirée d’un traditionnel américain. Dans les pins se lit donc avec gourmandise malgré l’air de déjà vu. On peut regretter que ces histoires soient plus fortes une fois contextualisées que nues, mais la nature du projet imposait probablement l’explication de texte.
L’été Diabolik
Thierry Smolderen et Alexandre Clérisse – Dargaud
Vous souvenez-vous de cette pendaison de crémaillère ? Nous étions conviés par le professeur à l’inauguration de sa nouvelle villa, designée par un architecte qui avait manifestement pris grand plaisir à répartir le mobilier vintage et toute une collection d’objets colorés rappelant l’esthétique des sixties. Oubliés, l’âge atomique et le Bauhaus du pavillon précédent. Une constante néanmoins dans la méticulosité : chaque bibelot avait trouvé sa place, à cet endroit précis et pas vingt centimètres plus loin. Dans le séjour, les ombres portées par quelques lampes d’appoint sur lesquelles la poussière ne devait jamais avoir le temps de se poser confrontaient harmonieusement leurs diagonales. La bibliothèque débordait de bandes dessinées anciennes et de livres d’art parfois négligemment posés les uns sur les autres. Négligemment, vraiment ? Un verre de grand cru à la main, nous faisions le tour du propriétaire avec le professeur Smolderen, homme brillant qui détaillait tout ce que le lieu devait à sa propre histoire. Nous nous emmerdions un peu. Où avait-il déniché ce sous-pull ? Le jeune Architecte Clérisse était là lui-aussi, qui marchait dans les pas de notre hôte. Lui portait un tricot blanc emprunté à Rod Laver ou Stan Smith. Le malaise tenait à cette angoisse permanente de faire tomber quelque chose, ou de salir. Tout était à ce point parfait. Pas un cadre de travers, pas une négligence qui ne fût référentielle et bien sûr, délibérée. Le professeur nous raccompagna enfin. En remontant dans la Kangoo, j’ai souvenir de m’être gratté les fesses.
 Pouvoirpoint
Pouvoirpoint
Erwann Surcouf – Vide cocagne
Si le vaisseau spatial a été baptisé Entreprise, c’est en hommage à Star Trek autant que par opportunité : des gens y travaillent comme dans une firme, une entreprise au sens générique du terme, à la vocation mal définie. Leur boulot ne semble d’ailleurs pas beaucoup plus sérieux que celui des figurants à qui on a demandé d’appuyer sur des boutons lumineux en fronçant les sourcils pour donner l’impression qu’ils pilotent une fusée. Hiérarchie à respecter, chefaillons en action, performance, machine à café, esprit corporate. À ces manies entrepreneuriales qui n’ont pas évolué depuis le début du vingt-et-unième siècle s’ajoute une cohabitation de type universitaire, les jeunes employés se retrouvant après le taf dans la chambre de l’une ou l’autre pour faire plus ample connaissance et fumer de la drogue. Un stagiaire est bientôt promu à la tête du service « communication, corpo-média & bonne ambiance », chargé de la réalisation d’un diaporama de la plus haute importance. Ainsi iront les petits conflits, petites ambitions et amourettes que le lecteur endossant la combinaison du stagiaire découvrira en même temps que lui. Ajoutons que le vaisseau est sous la menace constante de « proximiens », des aliens dont l’existence est avérée puisque tout le monde en parle. Alors la tension monte au fur et à mesure qu’on s’approche d’Alpha du Centaure… Divertissement générationnel d’une ambition narrative certaine — près de 200 pages assez denses –, qui décevra peut-être ceux qui ont besoin d’académisme futuriste et de princesses galactiques à forte poitrine pour s’envoler loin de leur open space. Dommage car on passe un bon moment, à peine plombé par un coup de théâtre final anticipé depuis l’autre bout de la galaxie.
 Tungstène
Tungstène
Marcello Quintanilha – Ça et là
Une journée sur une plage de Salvador de Bahia. Quatre personnages dansent sur un fil et chacun pourrait entraîner les autres dans sa chute : un petit dealer, un militaire à la retraite, un flic violent et sa compagne sur le point de quitter l’appartement conjugal. Des pécheurs à l’explosif secouent vigoureusement le fil. Qui tombera ? Bien servie par un dessin efficace (dans le genre photographique), l’intrigue gagne en tension jusqu’aux dernières pages : réussite.
 Pancho Villa, la bataille de Zacatecas
Pancho Villa, la bataille de Zacatecas
Paco Ignacio Taibo II et Eko – Nada
Juin 1914. Les troupes révolutionnaires roulent en convoi vers une ville minière au cœur du Mexique, dernier obstacle avant la chute du général Huerta. De ce sinistre individu qui s’auto-proclama président après un coup d’état, nous avons retenu le surnom par la chanson éponyme : la cucaracha, le cafard. Sept cents révolutionnaires sur le carreau, dix fois plus dans l’armée fédérale. Un siècle plus tard, l’épopée sanglante est contée par un graveur et un écrivain du cru. Né espagnol, Paco Ignacio Taibo II a en effet émigré très jeune au Mexique avec sa famille pour fuir la dictature. Franco fumait sans doute moins de marijuana que Victoriano Huerta mais envisageait le monde de la même manière : à sa botte. Beau et noir comme le drapeau anarchiste, un livre d’images hors normes qui rend hommage à la révolution et ses acteurs. On peut seulement déplorer le traitement du texte au sein des pages : la raideur informatique de la police de caractères parasite la rusticité et les sinuosités de la gravure.
 Histoire de l’art macaque
Histoire de l’art macaque
Benoît Préteseille – Cornélius
Quand il ne dessine pas, Benoît Préteseille publie des “livres à voir”, cahiers de dessins contemporains réalisés par d’autres. Quand il dessine, c’est essentiellement pour interroger la pratique artistique et sa réception. Ici encore : entre deux ou trois arbres délimitant leur micro-société, des singes doués de parole inventeront la représentation, l’art officiel, le plagiat, la reproduction, le musée, la galerie, le naturalisme, l’abstraction, la spéculation, la performance et aussi la beauté. La force du récit réside en la fluidité de sa construction. On suit sans répit l’évolution bondissante des rapports sociaux et leurs corrélations avec la création artistique, chaque invention en appelant une autre jusqu’à une conclusion forcément ouverte, puisque l’histoire de l’art macaque ne pourra s’achever qu’avec la disparition des macaques eux-mêmes. Attendons encore un peu.
 Fun
Fun
Paolo Bacilieri – Ici même
Une bande dessinée racontant l’invention des mots croisés, voilà qui n’est pas banal. On peut néanmoins se demander pourquoi cela n’a pas été fait plus tôt tant les deux formes semblent complices, ne serait-ce que parce qu’elles ont germé à peu près simultanément dans les mêmes journaux américains. Des cases qui ne s’appréhendent pas dans n’importe quel sens. Parfois, la structure complexe et cryptique d’une grille dévoile davantage qu’une somme de mots déconnectés les uns des autres mais pour s’en rendre compte il faudra aller au bout du jeu, comme l’intrigue se résout dans les dernières lignes d’un texte à énigmes. Bacieleri élabore son récit comme s’il construisait une telle grille. En trame principale, l’amitié nouée entre un dessinateur de bandes et un professeur d’université qui travaille sur la rédaction d’une histoire des mots croisés — déjà des propos imbriqués. Cette trame croise plusieurs récits mineurs via quelques traces de pas dans la neige, un rendez-vous reporté, comme deux mots se rencontreraient par l’intermédiaire d’une seule lettre. La lecture évolue en va-et-vient, après une introduction remarquable dans son évidence formelle, qui établit la correspondance entre le gaufrier de la bande dessinée et le rectangle cher aux cruciverbistes. Grands amateurs de contraintes et de constructions non linéaires, Chris Ware (Building stories) et Georges Perec (La vie mode d’emploi) auraient pu parrainer cet ouvrage. Perec fut d’ailleurs un maître verbicruciste — c’est ainsi qu’on qualifie ceux qui inventent les grilles, et devrait à ce titre être convoqué dans le second tome d’une œuvre érudite et légère qui digresse en permanence sans jamais ennuyer le lecteur.
Le jour où ça bascule
Collectif – Les Humanoïdes associés
Extrait de la préface écrite par le patron des Humano : « l’ouvrage que vous tenez entre vos mains — ou qui s’affiche sur votre tablette — dans lequel quatorze auteurs explorent leur point de rupture, est publié à l’occasion du quarantième anniversaire des Humanoïdes associés. Il traduit cette volonté à faire cohabiter — voire fusionner — comic américain, manga et bande dessinée. Bel exemple de la diversité du genre aujourd’hui. Il en souligne aussi implicitement — et involontairement — certains travers, comme la sous-représentation des auteurs femmes dans la profession. »
Venant d’un éditeur, une telle accumulation de grossièretés relève du miracle. Passons rapidement sur l’allusion à la tablette — les Humano pratiquent le livre numérique et tiennent à le faire savoir. Ils pratiquent aussi des prix prohibitifs pour leurs livres ordinaires mais ce n’est pas le sujet. Selon Fabrice Giger : 1- la bande dessinée (neuvième art) est un genre. Nous en déduirons que le cinéma (septième) ou la musique (quatrième) sont aussi des genres, la question étant maintenant de trouver de quels genres il s’agit. 2- Le “comic américain” et le manga ne sont pas de la bande dessinée, même s’ils appartiennent au même genre. Va comprendre. 3- Nous devrions regretter une « sous-représentation des auteurs femmes dans la profession ». Il est pourtant peu probable qu’on ait imposé son choix à l’éditeur qui a « involontairement » sélectionné quatorze auteurs couillus en oubliant que Métal Hurlant publia en son temps un certain nombre d’auteures, en oubliant surtout Ah!Nana, quand les Humano voulaient mettre en avant la bande dessinée féminine (avec tous les bémols que cette expression requiert). C’était il y a longtemps, avant Fabrice Giger. Mais le livre ? Ah oui, le livre. Juxtaposition de fonds de tiroirs et de tentatives plus ou moins heureuses de se raccrocher au projet, le titre-valise pouvant signifier à peu près tout et son contraire. Cerise commerciale sur le gâteau : l’image de Bilal en couverture, un portrait bleuâtre de plus qui ne dépareillerait pas dans la salle d’attente de mon dentiste.
 Encore une partie de campagne gâchée par le crocodile
Encore une partie de campagne gâchée par le crocodile
Stephen Collins – Cambourakis
Recueil de strips humoristiques rappelant le travail d’un autre sujet de Sa gracieuse Majesté, Tom Gauld et son génial Vous êtes tous jaloux de mon jetpack. Plus générationnelles, moins intéressées par Shakespeare et la littérature, ces pages issues du Guardian se concentrent essentiellement sur la modernité technologique et l’utilisation aliénée de l’écran. Quel qu’il soit, le sujet sera toujours traité par l’absurde avec une rage policée du meilleur goût. Oublions alors l’épaisse et trop longue Barbe du mal publiée chez le même éditeur à l’hiver dernier : Stephen Collins est bien plus convaincant dans ces formes courtes.
 Hipster than ever
Hipster than ever
James – Jungle
James livre une étude sociologique sur cet animal tatoué à poil long (parfois) qui aime prendre le soleil aux terrasses des cafés parisiens même si ces cafés sont en province, un animal inoffensif à bien des égards, web designer, pubard, chargé de com, créatif multi-cartes, trentenaire journaleux, enseignant, animateur, qui aime les légumes et les galettes de vinyle, lutte avec son smartphone contre les courants dominants, pédale sur le bitume urbain avec Fernand avec Firmin et puis Paulette. Un animal urbain qui parfois s’en prend plein la gueule au seul motif qu’il est en terrasse ou dans une salle de concert. James ne lui veut pas de mal, il s’en moque gentiment parce qu’il est facile de se moquer de celles et ceux qui, à force de vouloir montrer leur différence, finissent par ressembler à tous les membres du club. Il connaît bien son sujet et tente même une approche historique en convoquant Cab Calloway et les zoot-suits (qui n’ont pourtant pas grand-chose à voir avec les pantacourts). Caricatural bien sûr, drôle sans être fielleux, un petit livre de gags bien sentis publié par un éditeur qu’on pensait garder à distance parce que vraiment trop mainstream, quelle horreur.
 Le courant d’art
Le courant d’art
Bezian – Soleil
Par quel bout commencer ? Il n’y a pas de vrai début ni de fin à ces deux histoires de couleurs primaires et d’à-plats géométriques qui n’en forment qu’une. Si on suit le fil chronologique, celle du mathématicien Oliver Byrne qui écrivit un livre fou dont Mondrian s’inspira peut-être s’impose à cause de l’antériorité, mais l’éventualité qu’un rêve prémonitoire figurant les acteurs et éléments du Bauhaus ait suggéré son œuvre à Byrne n’est pas à exclure… Alors, qui vient en premier ? Peu importe. La structure en accordéon du Courant d’art inspire une lecture continue, le même geste de la main permettant de suivre une première évocation avant de basculer à la seconde. Et les deux se répondent absolument : instantanés d’existences, rivalités amoureuses et professionnelles, conclusions en forme d’hommage à celui qui se trouve de l’autre côté. Au cœur de chaque récit, la disruption temporelle qui annonce le Bauhaus chez Byrne et rappelle les éléments d’Euclide à Gropius et Mondrian, altère la rigueur chromatique avec laquelle jongle Bezian. Notons que ce n’est pas la première fois que l’auteur dont on connaît l’art incisif témoigne de son goût pour les formes géométriques et minimalistes — voir les Garde-fous (Glénat).
 Safari lune de miel
Safari lune de miel
Jesse Jacobs – Tanibis
Débute sur cette jolie formule : « il existe un avenir si radieux qu’en regardant au loin dans la bonne direction, on peut le voir scintiller ».
Un couple séjourne dans un espace vert indéterminé entre savane et brousse, où ils chasseront l’animal avant de retourner à la civilisation. Comme la faune est toxique — on tue mais on ne mange pas, leur guide a emporté suffisamment de provisions pour mitonner des plats dignes des plus grandes tables. Isolé dans une nature assez peu hostile sans qu’on puisse autant la qualifier d’amicale, le trio est observé, parfois entrepris par des parasites peu ragoutants qui se faufilent dans votre oreille ou vous bouffent la langue pour mieux la remplacer. L’idée vous révulse alors vous plissez le nez. Pourtant, les parasites n’ont jamais été aussi graphiques et doucement représentés. La trichromie foisonnante et méticuleusement organisée de Jesse Jacobs (les tons sont verts, naturellement) fascine et ensorcelle. On ne serait pas tout à fait surpris de rencontrer au détour d’une page Frank ou le pupshaw de Jim Woodring, égarés dans ce monde qui n’est pourtant pas le leur, mais le cousinage reste lointain et le travail de Jesse Jacobs suffisamment singulier pour n’appeler aucune référence directe. À découvrir absolument.
